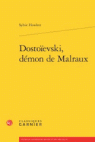
Malraux à la lumière de Dostoïevski
1Rares sont les ouvrages de critique dont on peut dire sans risque de se tromper qu’ils répondent à une nécessité : le livre de Sylvie Howlett est de ceux‑là. S. Howlett avoue sa dette, certes, envers ses prédécesseurs : André Lorant qui, en 1971, avait longuement comparé Tchen à Kirilov, ou Rachid Hiati dont la thèse André Malraux lecteur de Nietzsche et de Dostoïevski (soutenue en 2001 à l’Université Lille 3) n’a malheureusement pas encore été publiée. Mais l’étude de S. Howlett peut se prévaloir d’une exhaustivité jamais atteinte jusque‑là. Elle exploite, en effet, tous les textes que l’édition des œuvres complètes de la Pléiade met aujourd’hui à notre disposition, auxquels elle ajoute d’autres textes importants qui n’ont pu trouver place dans cette édition, particulièrement les annotations de Malraux au livre de Gaëtan Picon et les entretiens avec Frédéric Grover, mais aussi et surtout les réponses de Malraux à Manès Sperber à l’occasion d’un colloque sur Dostoïevski organisé en 1971, Wir und Dostojewskij — texte fort peu connu, que S. Howlett a elle‑même traduit et présenté en 1999 dans la Revue des lettres modernes, André Malraux, n° 10. Elle traque ainsi avec une scrupuleuse vigilance toutes les occurrences de « Dostoïevski » chez Malraux et elle nous force à reconnaître que celles‑ci sont innombrables, allant bien au‑delà des trois références « obsessionnelles » souvent citées par la critique : l’antériorité des scènes sur les personnages (prouvée par l’interversion du rôle de certains d’entre eux dans les manuscrits), la scène de la veillée funèbre de Nastassia par Mychkine et Rogojine dans L’Idiot, et la fameuse déclaration d’Ivan Karamazov qui veut « rendre son billet » à Dieu si « l’harmonie du monde » doit se payer du supplice d’un enfant. Parmi beaucoup d’autres exemples qui prouvent combien fine et attentive a été la lecture de Dostoïevski par Malraux, retenons son allusion, dans Les Voix du silence, aux « portes » et « porches » dans le roman Les Pauvres Gens (qui n’est pas un des plus célèbres) — allusion magistralement analysée par S. Howlett (p. 159‑163).
Présences de Dostoïevski
2Dans la première partie de son ouvrage (« Les Métamorphoses de Dostoïevski »), S. Howlett passe en revue les quelques écrivains et essayistes français qui, avant Malraux, ont fait découvrir à leurs pairs l’originalité et la puissance de l’œuvre dostoïevskienne : Gide, Suarès, Chestov, Faure, Proust… Mais elle nous montre qu’on ne peut se contenter d’ajouter le nom de Malraux à cette liste assez hétéroclite car il devint, nous dit‑elle, un véritable « théoricien de la littérature dostoïevskienne », qui plaça l’œuvre de Dostoïevski au cœur de sa réflexion sur la littérature. Explicitement souvent, mais aussi implicitement — et l’un des grands mérites des analyses de S. Howlett est de nous faire découvrir toute l’étendue et toute la profondeur de cette référence implicite. Lors de ses débuts sur la scène littéraire parisienne, Malraux fut d’emblée sensible à cet intérêt marqué pour ce qu’on appelait volontiers « le roman russe », et pour les romans de Dostoïevski en particulier. Il fut, à la NRF notamment, le témoin de ces débats où l’on instrumentalisait ces romans à telle ou telle fin de polémique et ne tarda pas d’ailleurs à s’apercevoir qu’ils étaient mal traduits et mal lus. Mais ce que démontre le livre de S. Howlett, c’est que sa vision personnelle de Dostoïevski dépassa très tôt aussi le contexte étroit de ces querelles qui, à la lumière de l’œuvre dostoïevskienne considérée enfin dans toute son ampleur et dans toute sa force, apparaissaient à la fois myopes et périmées.
Composition & personnage
3Ce dépassement opéré par Malraux est particulièrement mis en évidence sur deux points clés de la théorie de la littérature : la question de la composition romanesque et la question du personnage.
4Dès avant 1914, le débat sur la composition romanesque avait opposé, on le sait, Gide (et, à ses côtés, toute la NRF) à Paul Bourget. Ce dernier plaidait pour le roman « à thèse » (ou « à idées ») qui exigeait de l’écrivain une finalité claire (la thèse à illustrer), un programme bien établi, en bref un sens de l’ordre et de la composition qui, par bonheur, était, selon Bourget, une des vertus innées du « génie français », rationnel, cartésien. En 1913 déjà, l’article de Rivière sur « le roman d’aventure » avait au contraire vanté les mérites d’un roman foisonnant, à l’écriture elle‑même aventureuse, imprévisible, illogique, sur le modèle des romans anglais de Stevenson ou des romans russes de Dostoïevski. Thibaudet, au début des années 1920, se chargea pour sa part de tourner en dérision les idées de Bourget sur la composition « à la française » ; ses articles de la NRF montraient bien qu’on avait là affaire à l’une des facettes de cette critique de la rhétorique (et surtout de son enseignement, souvent présenté comme une spécialité des frères Jésuites) qui avait marqué, en France, toute la fin du xixe siècle. On trouve encore des traces de cette querelle dans certains articles de Malraux, notamment dans le premier de ses articles sur Guilloux, qu’il loue d’être dépourvu de ce « sens de la composition » qui n’est rien d’autre, dit Malraux, qu’« un moyen de séduction1 ». Mais Malraux, nous montre S. Howlett, dépassa vite cette problématique d’un autre temps en comprenant que la notion rhétorique, voire scolaire, de « composition » devait être englobée et, en quelque sorte, oubliée, périmée, dans une conception de l’œuvre d’art qu’imposait avec toute la force de l’évidence, la modernité tant littéraire que picturale ou musicale. L’œuvre d’art, une fois reconnue comme telle, absolutise ou, pour le moins, légitime sa « composition », si déroutante que celle‑ci puisse paraître aux yeux d’une étroite logique cartésienne appliquée de l’extérieur alors que plus rien, dans l’œuvre, ne l’appelle. La thèse de S. Howlett est alors lumineuse et peu contestable : dans le domaine littéraire, c’est à sa compréhension personnelle de l’œuvre dostoïevskienne que Malraux doit ce constat. Le second article sur Guilloux (« Le sens de la mort », préface au Sang noir) le confirme d’ailleurs : Malraux ne s’y attarde plus sur la notion de composition mais, en comparant Guilloux à d’autres romanciers russes, il demande à ce que cette œuvre, Le Sang noir, le consacre comme un Dostoïevski français.
5De même que l’œuvre légitime de facto sa composition spécifique et, en quelque sorte, lui préexiste, la scène préexiste au personnage. Et là encore, montre S. Howlett, ce principe fondamental et maintes fois réitéré de l’esthétique romanesque de Malraux s’appuie sur sa lecture de Dostoïevski. Ce n’est pas le moindre mérite des analyses de S. Howlett que de nous permettre de faire le lien entre cette manière de poser la question du personnage et la manière dont s’est posée à Malraux la question de la composition. Et S. Howlett nous oblige à reconnaître que c’est par la lecture que Malraux a faite de Dostoïevski que ce lien s’est forgé.
6Elle note en effet que Malraux a été particulièrement sensible à ce que d’aucuns ont appelé l’illogisme, voire l’invraisemblance psychologiques des personnages dostoïevskiens. Elle rappelle qu’il avait souligné que dans les Carnets de l’écrivain russe, « Rogogine et Mychkine sont d’abord un seul personnage et [que] c’est ensuite qu’il les a distingués » (Malraux cité par S. Howlett, p. 87). Dostoïevski a compris qu’un seul et même individu pouvait être à la fois un scélérat et un saint et plusieurs de ses héros (le Stavroguine des Démons, par exemple) sont pétris de ces contradictions et incohérences psychologiques et/ou biographiques que condamnerait la vraisemblance aristotélicienne. Et c’est là que les analyses de S. Howlett apportent un éclairage nouveau sur la façon dont Malraux a envisagé, grâce à sa compréhension personnelle de Dostoïevski, les rapports entre scène et personnage. C’est Dostoïevski en effet qui lui a montré comment on pouvait faire croire à un personnage qui nous paraîtrait proprement inconcevable, impossible, si on lui appliquait les catégories que nous croyons pouvoir appliquer à la connaissance des êtres humains en général : reconstitution biographique de son existence, cohérence et vraisemblance de sa psychologie, etc. Ce moyen, c’est, bien sûr, la scène romanesque : un romancier dostoïevskien n’est pas celui qui insère un personnage préalablement conçu dans une situation, une scène, c’est celui qui crée littéralement son personnage par une scène. Ainsi s’explique avec une particulière clarté l’une des formules les plus souvent employées par Malraux dans ses discours sur l’art véritable qui consiste, dit‑il, à transformer « un destin subi » en « un destin dominé ». Le romancier dostoïevskien est celui qui réussit cette transformation parce que son art nous permet de croire en des êtres qui nous paraîtraient, sans lui, simplement monstrueux et inconcevables, des êtres que nous ne « dominerions » en aucune manière et qui, par conséquent appartiendraient à ces forces inconnaissables du destin auxquelles nous ne pouvons donner aucune forme, sur lesquelles nous n’avons aucune maîtrise. Cette capacité à transformer un « destin subi » en « destin dominé » est aussi ce que Malraux appelle, dans une référence encore plus directe à Dostoïevski, la « prédication » d’un artiste ou d’un écrivain. Force est donc de reconnaître avec S. Howlett, et grâce à elle, que la référence à Dostoïevski éclaire ces points essentiels de la réflexion de Malraux sur la littérature et sur l’art en général.
Réminiscences de Dostoïevski
7Dans la longue troisième et dernière partie (« Une intertextualité démonique »), Sylvie Howlett repère, toujours avec la même finesse et la même vigilance, toutes les traces laissées dans l’œuvre de Malraux par sa lecture de Dostoïevski. Elle fait ainsi surgir une foule d’échos et de réminiscences qui resteraient imperceptibles pour qui n’aurait pas la même connaissance de Dostoïevski que cette lectrice passionnée et hyper‑attentive. On retiendra, parmi de nombreux autres exemples, les jugements portés par Versilov (dans L’Adolescent) ou par Ivan Karamazov sur les Européens et leurs cimetières (p. 202‑203), transposés dans La Tentation de l’Occident, les évocations d’araignées, figures terrifiantes, ancrées dans l’inconscient, de ces mères porteuses de mort si bien décrites par Lyotard dans Signé Malraux, l’engagement de May de suivre Kyo jusqu’« au bagne », écho de celui de Sonia envers Raskolnikov (dans Crime et Châtiment) (p. 248), l’écho du Joueur chez le Clappique de La Condition humaine, ou encore les réminiscences des Souvenirs de la maison des morts et de L’Adolescent dans Le Temps du mépris.
8Par l’étude de l’intertextualité, S. Howlett parvient aussi à des suggestions tout à fait neuves et intéressantes, comme celle d’un rapprochement non plus seulement entre Tchen et Kirilov, comme l’avait fait André Lorant, mais entre Raskolnikov et Garine — rapprochement qui n’a d’ailleurs peut‑être pas été étranger à la conception du personnage de Hugo dans Les Mains sales de Sartre. Ce qu’il y a de certain, c’est que ce rapprochement, d’ailleurs solidement argumenté par S. Howlett avait été longtemps occulté, avant elle, par la prise en compte peut‑être excessive, surtout au moment de la première publication des Conquérants, du contexte historique et politique dans lequel évolue Garine. La suggestion de S. Howlett vient nous rappeler, ou nous avertir, que le personnage de Malraux ne se réduit pas à sa définition contextuelle (les débuts de la révolution chinoise, la lutte contre les puissances coloniales, la Troisième Internationale, etc.) mais qu’il a une profondeur à laquelle la comparaison avec Raskolnikov sert de révélateur. Autre suggestion quelque peu inattendue mais qui peut ouvrir des perspectives de recherche nouvelles et passionnantes, celle d’un parallèle probable entre le « monde slave » tel qu’il est évoqué par Dostoïevski et « l’Orient » tel qu’il est évoqué dans La Tentation de l’Occident. Là encore, cette perspective a pu être occultée par l’importance donnée, surtout par les contemporains, au rôle que Malraux prétendait avoir joué en Asie, mais aussi par l’intérêt particulier porté aux travaux des spécialistes de l’Inde, de la Chine et du Japon au moment où Malraux publie ce livre.
***
9On pourrait souligner que le « daïmôn » dostoïevskien que Sylvie Howlett prête à Malraux ne ressemble guère à celui de Socrate. La meilleure traduction de ce mot grec semble bien être, en l’occurrence, celle que propose S. Howlett elle‑même : « poisson ‑pilote ». Le lecteur a parfois même l’impression, au fil des pages, que cette traduction est encore trop timide et que celle de « modèle », voire de staretz serait plus fidèle à la sensibilité critique de l’auteure. Mais à de nombreuses reprises S. Howlett prend soin de souligner ce qui, sur tel ou tel thème, sur telle ou telle modalité d’écriture, distingue et éloigne Malraux de ce maître dont il a su s’émanciper, tout comme il avait su, grâce à lui, s’émanciper de tous ceux qui, en son temps, pouvaient prétendre au titre de « maitres à penser » (Barrès, Gide, voire Bourget ou même Maurras). On peut donc bien regretter, avec S. Howlett, qu’il n’ait jamais écrit pour Dostoïevski, avant l’interview par M. Sperber signalée au début de cet article, l’équivalent des textes d’admiration qu’il avait donnés pour Gide, Laclos, Guilloux, Bernanos ou même Faulkner ou D. H. Lawrence. Bien plus que tous ceux‑là pourtant, S. Howlett nous le prouve, c’est Dostoïevski qui avait été, à ses yeux, l’initiateur et le modèle d’une mutation de la littérature à laquelle il estimait avoir participé en tant que romancier et qu’il s’est efforcé d’analyser en « théoricien de la littérature », notamment dans Néocritique et dans L’Homme précaire et la littérature.
10Il est clair que, dans cet ouvrage, S. Howlett apparaît autant comme une spécialiste de Dostoïevski que de Malraux. Au regard de la démonstration que son livre nous apporte, il serait évidemment absurde de le lui reprocher. Et si les admirateurs de Malraux auront parfois l’impression d’un certain déséquilibre en faveur de l’écrivain russe, ils se féliciteront de cet excès nécessaire et bénéfique sans lequel n’aurait pu être donné cet éclairage nouveau et ô combien révélateur de l’œuvre et de la pensée de Malraux.

